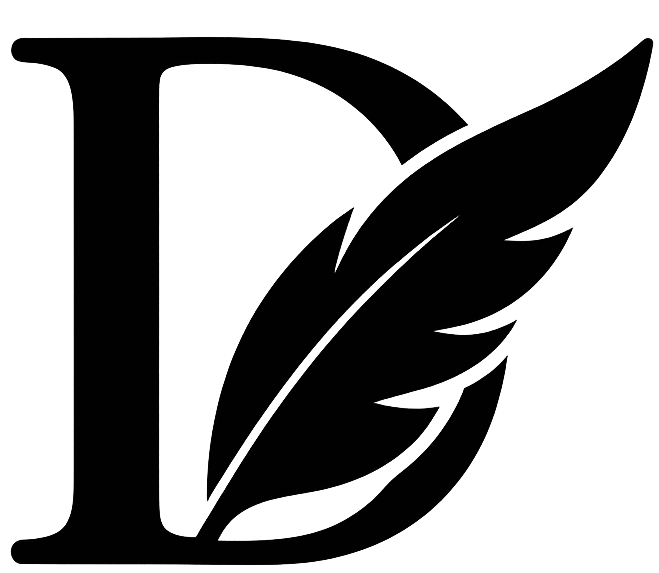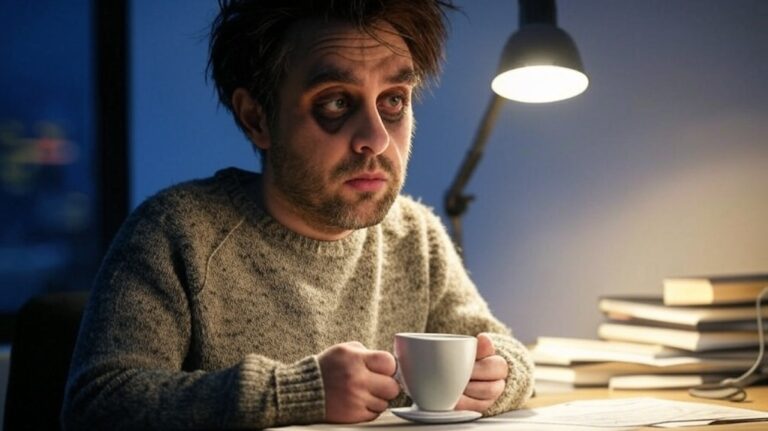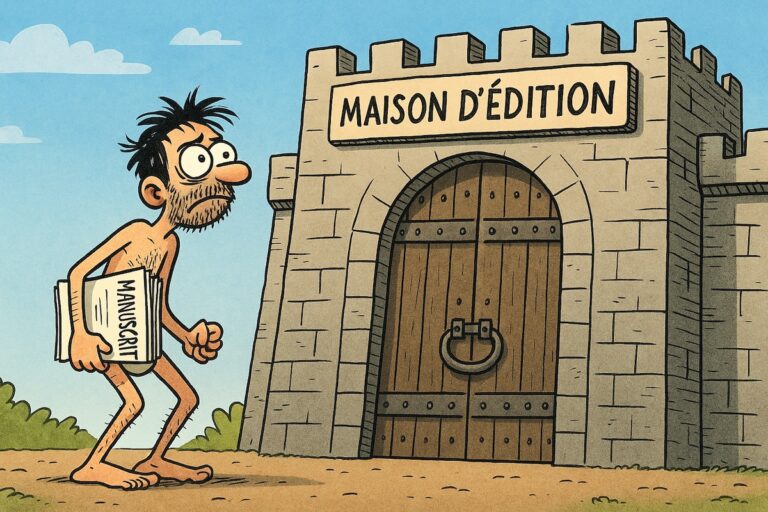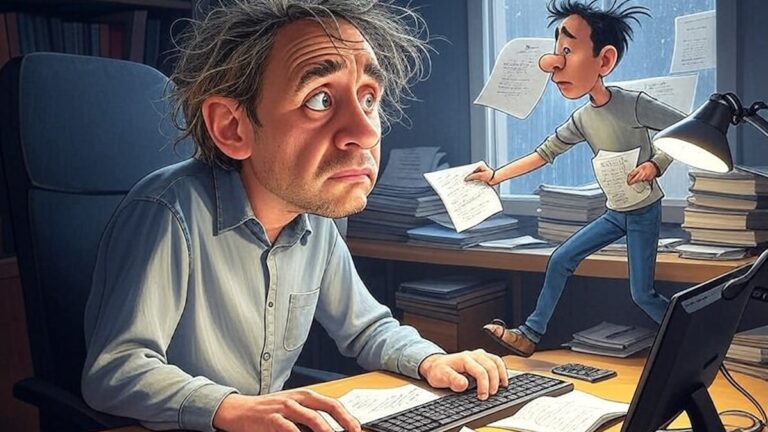Autrefois, on envoyait son manuscrit par la poste, accompagné d’un mot manuscrit vaguement tremblant et d’un espoir secret.
Aujourd’hui, on te demande un pitch.
Un résumé vendeur. Court, clair, efficace.
400 caractères espaces compris.
Autrement dit : une fiche produit pour ton chaos personnel.
Ton livre ? Non, ton produit d’appel
On ne te demande pas ce que tu as vécu, ni pourquoi tu as mis trois ans à trouver la bonne chute.
On veut une phrase d’accroche.
Quelque chose qui « interpelle ».
Comme si ton enfance, tes fantômes et ta colère pouvaient se plier à un brief marketing.
« Une autofiction mordante sur la survie affective dans une famille en ruines. »
Voilà. Trois mois de réécriture, condensés en punchline.
Le pitch, cette porte d’entrée… avec interphone cassé
Tu t’appliques. Tu relis. Tu coupes.
Tu veux faire envie sans en dire trop. Montrer la voix du texte sans sombrer dans l’étiquetage.
Mais parfois, tu te demandes si le pitch ne sera pas lu avant même ton nom.
Et pire : s’il sera la seule chose lue.
Alors tu ajustes les mots comme une bombe à retardement.
Tu mets un « résilience » par-ci, un « fracture intime » par-là.
Tu veux être littéraire, mais pas pompeux.
Original, mais pas barré.
Bref : tu veux plaire… sans te trahir (trop).
400 caractères, 12 névroses
Le paradoxe, c’est que tu peux écrire 60 000 mots sans trembler, mais ces 400 caractères-là ?
Ils te réduisent à l’état de stagiaire en panique.
Tu pèses chaque virgule. Tu changes « et » en « mais ». Tu demandes à dix proches ce qu’ils en pensent.
Et quand tu l’envoies ?
Tu actualises tes mails comme un ado en attente de « vu ».
Conclusion lucide
Le pitch à l’éditeur, c’est la bande-annonce d’un film que t’as tourné seul, sans budget, avec ton cœur.
Tu sais qu’il ne dit pas tout.
Mais s’il rate… personne ne verra jamais le film.
Alors tu l’écris, tu le retravailles, tu le maudis.
Et tu finis par l’envoyer.
Avec, dans la gorge, ce vieux mélange de honte, de fierté et d’espoir minuscule.